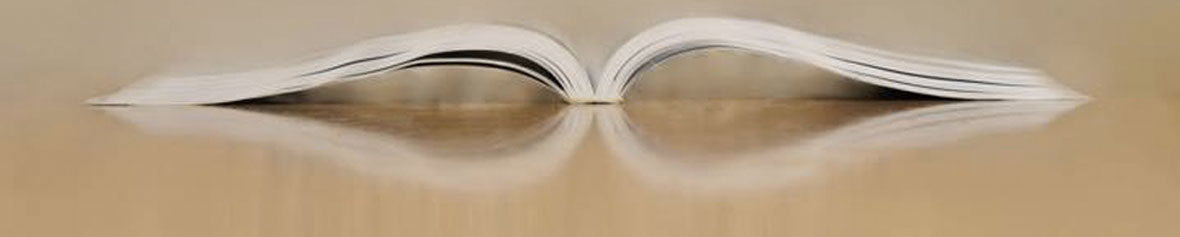Illustrations: Anne DAYOT
Dr Adrian CHABOCHE
Je prends mes désirs pour des réalités car je crois à la réalité de mes désirs.
Chères lectrices, chers lecteurs,
La pratique de l’hypnose est passionnante par son infinité de possibilités ! Il y a bien évidemment celle de la singularité de la rencontre avec le patient, quels que soient son motif, sa souffrance et son identité unique. Mais penchons-nous un instant aussi sur les « techniques » ou « exercices » que nous proposons aux patients. Il en existe une diversité, si grande que les seuls livres ayant l’ambition de faire croire que pour tout problème il y aurait une ou deux techniques à utiliser au moyen d’un script bien pensé certes, mais tout à fait déconnecté de l’insaisissable moment rencontré avec le patient, les font passer pour des catalogues plus artificiels que rassurants.
Lors de notre rencontre avec l’apprentissage de l’hypnose nous avons tous eu la crainte de « ne pas savoir quoi dire ». Et c’est vrai qu’elle nous expose à plonger irrémédiablement dans notre créativité. Tant mieux, alors nous sondons notre subjectivité dans le cadre de l’accompagnement de notre patient afin de trouver le bon mouvement thérapeutique à lui proposer. Et donc chaque rencontre devient unique.
Bien évidemment, et heureusement, nous ne réinventons pas tout à chaque reprise. Il faut bien que l’expérience serve à quelque chose. Et il est certain aussi que l’empreinte de notre propre personnalité entraîne des préférences quant à l’usage de certaines « techniques » plus que d’autres. C’est aussi ce qui nous rend présents humainement dans l’interaction thérapeutique avec le patient, notre personnalité s’exprime aussi par le choix d’une expérience, d’un « exercice » ou d’une proposition hypnotique plutôt qu’une autre...
Il vous semblera que vous faites toujours différemment, mais vous le faites autour de certains points de repères qui reviennent régulièrement. Un collègue me disait par exemple n’utiliser que rarement la technique dite du « gant magique », tandis qu’un autre la considère au cœur de sa pratique. C’est une restitution simple de tout un parcours que vous avez éprouvé pour découvrir, apprivoiser et vous approprier ces grands repères de pratiques cliniques. Chaque technique, exercice, proposition hypnotique, nous les avons rencontrés, vécus, et ceux que nous utilisons donc ont une résonance subjective pour chacun de nous. Raison aussi pour laquelle je mets des guillemets lorsque nous en évoquons le terme « technique » ou « exercice » car aucun de ces termes ne rend suffisamment compte de ce qu’ils représentent comme travail d’art de l’avoir conçu à votre façon, autant que tout artisan a su affiner ses outils à sa propre pratique.
Si parmi ces outils il y en a bien un qui est connu de façon unanime, c’est celui de la réification. En philosophie réifier signifie « transformer / donner le caractère à ». Cet outil permet de proposer au patient de se représenter l’objet de son problème (qu’il soit mental ou physique) sous une forme représentée qui peut apparaître à notre observation. Comme un objet, qui serait posé à une certaine distance. L’induction permet de concentrer l’attention du patient et de favoriser alors un mécanisme de production inconsciente de représentation subjective, symbolique, du problème concerné. Ainsi une douleur peut devenir une forme, plus ou moins concrète ou précise, un cactus entre les mains de cette patiente, ou plus flou, une couleur dont la nuance n’est donc connue que de la personne. La réification permet d’une part de rendre représentable ce qui ne l’est pas, comme dans le processus de l’art-thérapie.
D’autre part, la fonction symbolique de l’expérience met en scène une distanciation : l’objet se trouve à un endroit que l’on imagine comme posé devant notre observation. Intérieurement, le patient se l’imagine à l’extérieur.
Alors il y a une représentation au croisement de la manifestation consciente, volontaire par l’imaginaire actif, et inconsciente, l’état de transe hypnotique favorisant l’accès au pré conscient, partie « à cheval » entre ce qui est manifesté mentalement et ce qui reste hors de notre portée, dans l’inconscient.
C’est donc déjà un procédé très intéressant, qui se distingue du rêve (où il n’y a pas l’implication volontaire de traiter d’un sujet en particulier) et de l’imaginaire simple (puisqu’aussi on ne choisit pas de représenter le problème d’une façon prédéterminée). Alors apparaît pour notre patient une manifestation « représentée et représentable » de sa souffrance, à une distance émotionnelle sécurisante. Cet objet peut être contemplé, soit pour observer des changements y apparaître spontanément, soit c’est l’objet lui-même qui est déplacé par l’action du patient, soit c’est ce dernier qui bouge autour. Intéressons-nous alors à ce procédé, simple s’il paraît, et pourtant d’une profondeur étonnante.
Une grande question qui peut nous emmener loin : qu’est-ce que le « réel » ?
Si nous plongeons dans certains univers cinématographiques, par exemple des frères (devenues entre-temps sœurs) Wachowski et leur suite de films « Matrix », nous ne vivons que dans un monde virtuel, bien que perceptible sensiblement, lequel n’est qu’une coquille destinée à nous garder dans une idée de la réalité, tandis qu’en dehors il en existerait une autre...
Pour les astrophysiciens, la définition du Réel est bien complexe aussi : il n’existe que lorsqu’il est constaté par un observateur. En dehors de ce moment, particules et ondes sont tout à la fois partout et en plusieurs états (oui, je sais cette idée fait très mal à la tête pour tenter de la comprendre, et comme le disait Einstein, si vous m’avez compris c’est que vous ne m’avez pas bien écouté). Le réel serait donc uniquement défini par ce que l’on observe et notre présence consciente humaine.
Pour Lacan, le Réel « c’est quand on se cogne ». Le caractère « réel » est donc intrinsèquement lié à la perception que nous avons de notre environnement. Une chaise en elle-même n’existe pas. Aucune autre espèce vivante ne s’arrêtera devant en se disant « tiens, un fauteuil pour y installer mon séant ! ». Que ce soit son identité, sa définition, et son usage, l’objet n’existe pas. D’ailleurs, si l’on remonte un peu dans le temps, la chaise n’existe en rien dans la nature. Il s’agit de morceau de bois, de minerai de fer, parfois d’un peu de vache (pour le cuir), ou d’un tissu issu de plantes. Rien de plus. Matière transformée. Ces objets, autant qu’ils sont, ne sont qu’une définition communément admise par notre existence et permettant de pouvoir communiquer et mettre à disposition des usages destinés à notre vie, et initialement, à notre survie. Oui, car avant tout il fallait bien pouvoir montrer et nommer ce que l’humain a créé et transformé pour le transmettre.
L’humain a pourtant créé des universaux. À ce jour, à 99 % si vous présentez à un congénère, quels que soient sa culture, son pays, sa tradition, sa langue ou date d’existence, un siège, sans même avoir à le nommer, son cerveau sait quoi en faire. Pourtant il n’existe pas en dehors de notre conception. Il semblerait que nous confondions en partie le « réel » avec ce que nous créons ! Tandis que notre cher psychanalyste Jacques Lacan nous rappelle à une version peut-être plus saine : le réel c’est quand on se cogne. C’est-à-dire perception sensorielle. Non pas nommée, ce n’est pas le couplage signifiantsignifié, non, mais sensation avant tout. Celle qui nous renseigne sur ce qui est autour de nous, y compris le petit orteil rencontrant abruptement le coin de ce meuble. Bien réel.
« Avant, on cherchait à déformer la réalité en prenant du LSD. Maintenant que la réalité est déformée, on prend du Prozac pour tenter de la voir normalement. » Ou bien encore : « Connaissez-vous la différence entre un névrosé et un psychotique ? Eh bien le psychotique il pense que 2+2=5 et il se marre, tandis que le névrosé sait que 2+2=4 et il en est malade. » Ces petites incartades humoristiques pour détendre vos neurones.
Car regardez autour de vous. Et observez que rien « n’existe » en dehors de notre perception, représentation et façonnage mental. Lorsque vous regardez un objet votre cerveau indique à votre conscience par sa forme et son identité ce à quoi il peut vous servir, quelles interactions vous pouvez avoir, ou la façon dont vous pourriez le prendre dans votre main. Et nous arrivons à un point tout à fait passionnant à la lumière des neurosciences. Notre cerveau analyse en permanence ce que nous percevons de notre environnement. La vision bien sûr, mais les sons, les sensations tactiles, les odeurs, ou le goût (tiens, un bonjour du VAKOG !). Ces perceptions « brutes » sont transformées avant notre perception consciente en représentations codifiées qui ont un sens pour créer autour de nous un environnement qui semble naturel, tandis qu’il est issu d’une conceptualisation artificielle.
Et c’est ce sens qui donne cohésion à ce que nous nommons réel. Une chaise se tient en général auprès d’une table, d’un bureau, ou d’un lieu où on peut s’asseoir pour se reposer ou travailler. Cela a du sens. Ainsi, dès lors que nos yeux observent une forme disposant d’un empiètement au sol, d’un objet horizontal de la taille plus ou moins de notre séant, et éventuellement d’accessoires comme un objet vertical attenant pour y caler notre dos, voire des objets latéraux intermédiaires pour en faire des accoudoirs, nous savons que c’est un siège. Et en toute concordance notre cerveau nous informe d’un contexte attendu autour, qui aurait du sens.
Maintenant prenez la même chaise, et mettez-la dans un endroit discordant à ce réel attendu, vous en serez surpris, étonné. Peutêtre amusé, ou apeuré si par exemple cet objet se situait en un lieu en conflit avec votre représentation. Une pomme à l’endroit d’un visage dans un tableau montrant un homme avec un chapeau melon debout en costume dans un paysage avec une mer en fond nous surprend (tableau Le Fils de l’homme de René Magritte, peintre surréaliste) et bouscule notre vision habituelle des choses, comme Dali aussi le faisait pour étourdir nos perceptions et nos repères.
Ce que nous pensons réel tient au fait que notre cerveau interprète ce que nous percevons pour en faire instantanément une information cohérente qui a du sens. Cela nous permet aussi de donner lumière au phénomène traumatique d’une façon très intéressante : l’effraction « dans le réel » d’une situation qui n’a pas de sens, soit par son irruption soudaine, soit parce qu’elle va venir altérer la cohésion du réel par sa brutalité. L’agression fait irruption et destruction surtout lorsqu’elle n’a pas de sens (en plus des dégâts physiques occasionnés). Le propre de l’être humain c’est de produire du sens, nous dit Lionel Naccache, professeur en neurosciences.
Pour lire la suite...
Je prends mes désirs pour des réalités car je crois à la réalité de mes désirs.
Chères lectrices, chers lecteurs,
La pratique de l’hypnose est passionnante par son infinité de possibilités ! Il y a bien évidemment celle de la singularité de la rencontre avec le patient, quels que soient son motif, sa souffrance et son identité unique. Mais penchons-nous un instant aussi sur les « techniques » ou « exercices » que nous proposons aux patients. Il en existe une diversité, si grande que les seuls livres ayant l’ambition de faire croire que pour tout problème il y aurait une ou deux techniques à utiliser au moyen d’un script bien pensé certes, mais tout à fait déconnecté de l’insaisissable moment rencontré avec le patient, les font passer pour des catalogues plus artificiels que rassurants.
Lors de notre rencontre avec l’apprentissage de l’hypnose nous avons tous eu la crainte de « ne pas savoir quoi dire ». Et c’est vrai qu’elle nous expose à plonger irrémédiablement dans notre créativité. Tant mieux, alors nous sondons notre subjectivité dans le cadre de l’accompagnement de notre patient afin de trouver le bon mouvement thérapeutique à lui proposer. Et donc chaque rencontre devient unique.
Bien évidemment, et heureusement, nous ne réinventons pas tout à chaque reprise. Il faut bien que l’expérience serve à quelque chose. Et il est certain aussi que l’empreinte de notre propre personnalité entraîne des préférences quant à l’usage de certaines « techniques » plus que d’autres. C’est aussi ce qui nous rend présents humainement dans l’interaction thérapeutique avec le patient, notre personnalité s’exprime aussi par le choix d’une expérience, d’un « exercice » ou d’une proposition hypnotique plutôt qu’une autre...
Il vous semblera que vous faites toujours différemment, mais vous le faites autour de certains points de repères qui reviennent régulièrement. Un collègue me disait par exemple n’utiliser que rarement la technique dite du « gant magique », tandis qu’un autre la considère au cœur de sa pratique. C’est une restitution simple de tout un parcours que vous avez éprouvé pour découvrir, apprivoiser et vous approprier ces grands repères de pratiques cliniques. Chaque technique, exercice, proposition hypnotique, nous les avons rencontrés, vécus, et ceux que nous utilisons donc ont une résonance subjective pour chacun de nous. Raison aussi pour laquelle je mets des guillemets lorsque nous en évoquons le terme « technique » ou « exercice » car aucun de ces termes ne rend suffisamment compte de ce qu’ils représentent comme travail d’art de l’avoir conçu à votre façon, autant que tout artisan a su affiner ses outils à sa propre pratique.
Si parmi ces outils il y en a bien un qui est connu de façon unanime, c’est celui de la réification. En philosophie réifier signifie « transformer / donner le caractère à ». Cet outil permet de proposer au patient de se représenter l’objet de son problème (qu’il soit mental ou physique) sous une forme représentée qui peut apparaître à notre observation. Comme un objet, qui serait posé à une certaine distance. L’induction permet de concentrer l’attention du patient et de favoriser alors un mécanisme de production inconsciente de représentation subjective, symbolique, du problème concerné. Ainsi une douleur peut devenir une forme, plus ou moins concrète ou précise, un cactus entre les mains de cette patiente, ou plus flou, une couleur dont la nuance n’est donc connue que de la personne. La réification permet d’une part de rendre représentable ce qui ne l’est pas, comme dans le processus de l’art-thérapie.
D’autre part, la fonction symbolique de l’expérience met en scène une distanciation : l’objet se trouve à un endroit que l’on imagine comme posé devant notre observation. Intérieurement, le patient se l’imagine à l’extérieur.
Alors il y a une représentation au croisement de la manifestation consciente, volontaire par l’imaginaire actif, et inconsciente, l’état de transe hypnotique favorisant l’accès au pré conscient, partie « à cheval » entre ce qui est manifesté mentalement et ce qui reste hors de notre portée, dans l’inconscient.
C’est donc déjà un procédé très intéressant, qui se distingue du rêve (où il n’y a pas l’implication volontaire de traiter d’un sujet en particulier) et de l’imaginaire simple (puisqu’aussi on ne choisit pas de représenter le problème d’une façon prédéterminée). Alors apparaît pour notre patient une manifestation « représentée et représentable » de sa souffrance, à une distance émotionnelle sécurisante. Cet objet peut être contemplé, soit pour observer des changements y apparaître spontanément, soit c’est l’objet lui-même qui est déplacé par l’action du patient, soit c’est ce dernier qui bouge autour. Intéressons-nous alors à ce procédé, simple s’il paraît, et pourtant d’une profondeur étonnante.
Une grande question qui peut nous emmener loin : qu’est-ce que le « réel » ?
Si nous plongeons dans certains univers cinématographiques, par exemple des frères (devenues entre-temps sœurs) Wachowski et leur suite de films « Matrix », nous ne vivons que dans un monde virtuel, bien que perceptible sensiblement, lequel n’est qu’une coquille destinée à nous garder dans une idée de la réalité, tandis qu’en dehors il en existerait une autre...
Pour les astrophysiciens, la définition du Réel est bien complexe aussi : il n’existe que lorsqu’il est constaté par un observateur. En dehors de ce moment, particules et ondes sont tout à la fois partout et en plusieurs états (oui, je sais cette idée fait très mal à la tête pour tenter de la comprendre, et comme le disait Einstein, si vous m’avez compris c’est que vous ne m’avez pas bien écouté). Le réel serait donc uniquement défini par ce que l’on observe et notre présence consciente humaine.
Pour Lacan, le Réel « c’est quand on se cogne ». Le caractère « réel » est donc intrinsèquement lié à la perception que nous avons de notre environnement. Une chaise en elle-même n’existe pas. Aucune autre espèce vivante ne s’arrêtera devant en se disant « tiens, un fauteuil pour y installer mon séant ! ». Que ce soit son identité, sa définition, et son usage, l’objet n’existe pas. D’ailleurs, si l’on remonte un peu dans le temps, la chaise n’existe en rien dans la nature. Il s’agit de morceau de bois, de minerai de fer, parfois d’un peu de vache (pour le cuir), ou d’un tissu issu de plantes. Rien de plus. Matière transformée. Ces objets, autant qu’ils sont, ne sont qu’une définition communément admise par notre existence et permettant de pouvoir communiquer et mettre à disposition des usages destinés à notre vie, et initialement, à notre survie. Oui, car avant tout il fallait bien pouvoir montrer et nommer ce que l’humain a créé et transformé pour le transmettre.
L’humain a pourtant créé des universaux. À ce jour, à 99 % si vous présentez à un congénère, quels que soient sa culture, son pays, sa tradition, sa langue ou date d’existence, un siège, sans même avoir à le nommer, son cerveau sait quoi en faire. Pourtant il n’existe pas en dehors de notre conception. Il semblerait que nous confondions en partie le « réel » avec ce que nous créons ! Tandis que notre cher psychanalyste Jacques Lacan nous rappelle à une version peut-être plus saine : le réel c’est quand on se cogne. C’est-à-dire perception sensorielle. Non pas nommée, ce n’est pas le couplage signifiantsignifié, non, mais sensation avant tout. Celle qui nous renseigne sur ce qui est autour de nous, y compris le petit orteil rencontrant abruptement le coin de ce meuble. Bien réel.
« Avant, on cherchait à déformer la réalité en prenant du LSD. Maintenant que la réalité est déformée, on prend du Prozac pour tenter de la voir normalement. » Ou bien encore : « Connaissez-vous la différence entre un névrosé et un psychotique ? Eh bien le psychotique il pense que 2+2=5 et il se marre, tandis que le névrosé sait que 2+2=4 et il en est malade. » Ces petites incartades humoristiques pour détendre vos neurones.
Car regardez autour de vous. Et observez que rien « n’existe » en dehors de notre perception, représentation et façonnage mental. Lorsque vous regardez un objet votre cerveau indique à votre conscience par sa forme et son identité ce à quoi il peut vous servir, quelles interactions vous pouvez avoir, ou la façon dont vous pourriez le prendre dans votre main. Et nous arrivons à un point tout à fait passionnant à la lumière des neurosciences. Notre cerveau analyse en permanence ce que nous percevons de notre environnement. La vision bien sûr, mais les sons, les sensations tactiles, les odeurs, ou le goût (tiens, un bonjour du VAKOG !). Ces perceptions « brutes » sont transformées avant notre perception consciente en représentations codifiées qui ont un sens pour créer autour de nous un environnement qui semble naturel, tandis qu’il est issu d’une conceptualisation artificielle.
Et c’est ce sens qui donne cohésion à ce que nous nommons réel. Une chaise se tient en général auprès d’une table, d’un bureau, ou d’un lieu où on peut s’asseoir pour se reposer ou travailler. Cela a du sens. Ainsi, dès lors que nos yeux observent une forme disposant d’un empiètement au sol, d’un objet horizontal de la taille plus ou moins de notre séant, et éventuellement d’accessoires comme un objet vertical attenant pour y caler notre dos, voire des objets latéraux intermédiaires pour en faire des accoudoirs, nous savons que c’est un siège. Et en toute concordance notre cerveau nous informe d’un contexte attendu autour, qui aurait du sens.
Maintenant prenez la même chaise, et mettez-la dans un endroit discordant à ce réel attendu, vous en serez surpris, étonné. Peutêtre amusé, ou apeuré si par exemple cet objet se situait en un lieu en conflit avec votre représentation. Une pomme à l’endroit d’un visage dans un tableau montrant un homme avec un chapeau melon debout en costume dans un paysage avec une mer en fond nous surprend (tableau Le Fils de l’homme de René Magritte, peintre surréaliste) et bouscule notre vision habituelle des choses, comme Dali aussi le faisait pour étourdir nos perceptions et nos repères.
Ce que nous pensons réel tient au fait que notre cerveau interprète ce que nous percevons pour en faire instantanément une information cohérente qui a du sens. Cela nous permet aussi de donner lumière au phénomène traumatique d’une façon très intéressante : l’effraction « dans le réel » d’une situation qui n’a pas de sens, soit par son irruption soudaine, soit parce qu’elle va venir altérer la cohésion du réel par sa brutalité. L’agression fait irruption et destruction surtout lorsqu’elle n’a pas de sens (en plus des dégâts physiques occasionnés). Le propre de l’être humain c’est de produire du sens, nous dit Lionel Naccache, professeur en neurosciences.
Pour lire la suite...
Dr Adrian CHABOCHE

Spécialiste en médecine générale et globale au Centre Vitruve. Il est praticien attaché au Centre de traitement de la douleur CHU Ambroise- Paré. Il enseigne au sein du DU Hypnoanalgésie et utilisation de techniques non pharmacologiques dans le traitement de la douleur, Université de Versailles.
Revue Hypnose et Thérapies Brèves 77
N°77 : Mai / Juin / Juillet 2025
Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce numéro :
Editorial : « L’empathie et la compassion comme fil d’or du soin » Julien Betbèze
8 / En couverture : Anne Dayot De sable et d’algues Sophie Cohen
10 / Désamorcer les traumas et se replacer dans l’existence par la Psychothérapie du Trauma Réassociative (PTR) Marine Manouvrier et Gérald Brassine
20 / Chemsex, trauma et EMDR-IMO . L’échelle de mesure « croire en moi » Sophie Tournouër
28 / Cothérapie avec Romain Faire émerger les relations sécures Jérémie Roos
36 / La voie métaphorique en « super-inter-vision ». Comment développer la créativité. des soignants Claire Conte-Rossin et Catherine Martin
ESPACE DOULEUR DOUCEUR
46 / Introduction Gérard Ostermann
50 / Empathie et compassion Deux forces pour soigner autrement Olivier de Palézieux
61 / INTERVIEW Mylène Blasco Propos recueillis par Gérard Ostermann
68 / DOSSIER TOC
70 / La société contemporaine : Perfection et fabrique des TOC Grégoire Vitry et Emmanuelle Gallin
82 / La pensée magique dans les TOC Typologie des rituels magiques Claude Michel
QUIPROQUO
98 / Les obsessions S. Colombo, Muhuc
BONJOUR ET APRÈS...
102 / André et son ventre Pour une séance plus qu’émouvante Sophie Cohen
LES CHAMPS DU POSSIBLE
106 / Se cogner au réel Adrian Chaboche
CULTURE MONDE
114 / Dans les sanctuaires du shintō Bruno Bréchemier
LIVRES EN BOUCHE
120 / J. Betbèze et S. Cohen
125 ESPACE FORMATIONS
Illustrations: Anne DAYOT
Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce numéro :
Editorial : « L’empathie et la compassion comme fil d’or du soin » Julien Betbèze
8 / En couverture : Anne Dayot De sable et d’algues Sophie Cohen
10 / Désamorcer les traumas et se replacer dans l’existence par la Psychothérapie du Trauma Réassociative (PTR) Marine Manouvrier et Gérald Brassine
20 / Chemsex, trauma et EMDR-IMO . L’échelle de mesure « croire en moi » Sophie Tournouër
28 / Cothérapie avec Romain Faire émerger les relations sécures Jérémie Roos
36 / La voie métaphorique en « super-inter-vision ». Comment développer la créativité. des soignants Claire Conte-Rossin et Catherine Martin
ESPACE DOULEUR DOUCEUR
46 / Introduction Gérard Ostermann
50 / Empathie et compassion Deux forces pour soigner autrement Olivier de Palézieux
61 / INTERVIEW Mylène Blasco Propos recueillis par Gérard Ostermann
68 / DOSSIER TOC
70 / La société contemporaine : Perfection et fabrique des TOC Grégoire Vitry et Emmanuelle Gallin
82 / La pensée magique dans les TOC Typologie des rituels magiques Claude Michel
QUIPROQUO
98 / Les obsessions S. Colombo, Muhuc
BONJOUR ET APRÈS...
102 / André et son ventre Pour une séance plus qu’émouvante Sophie Cohen
LES CHAMPS DU POSSIBLE
106 / Se cogner au réel Adrian Chaboche
CULTURE MONDE
114 / Dans les sanctuaires du shintō Bruno Bréchemier
LIVRES EN BOUCHE
120 / J. Betbèze et S. Cohen
125 ESPACE FORMATIONS
Illustrations: Anne DAYOT